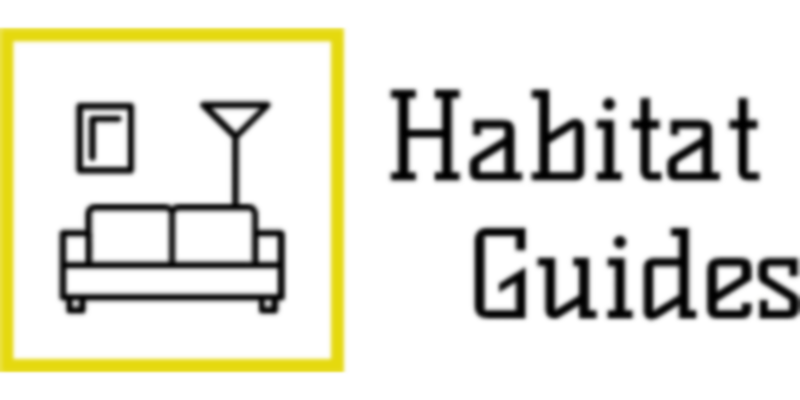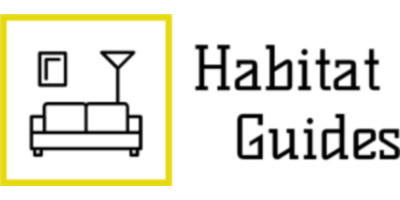Un mur laissé nu face à l’humidité, c’est ouvrir la porte aux dégâts, même dans des bâtiments à peine sortis de terre. Les textes réglementaires restent hésitants : ils n’exigent pas toujours la présence d’une protection physique contre les remontées d’eau, alors que les sinistres liés à l’humidité ne cessent de se multiplier.
Des solutions techniques existent, parfois sous-estimées, capables de freiner durablement l’invasion de l’eau dans la maçonnerie. Les spécialistes s’accordent sur l’efficacité d’un dispositif d’apparence modeste, mais dont la présence conditionne la solidité des murs pour des décennies.
Pourquoi l’humidité menace la solidité des maisons
L’humidité ne laisse pas de simples traces sur les murs. Elle s’infiltre, s’attaque à la structure même de la maison. Quand les remontées capillaires s’invitent, l’eau du sol grimpe lentement par les murs, logeant dans les pores de la pierre, de la brique, du béton. Ce climat devient alors idéal pour que moisissures et salpêtre s’installent. Et, à force, la maçonnerie se délite : les enduits boursouflent, les joints se délitent, les murs perdent en cohésion.
L’humidité n’abîme pas seulement l’esthétique. Elle joue sur la santé de ceux qui vivent là : aggravation des allergies, problèmes respiratoires, murs froids au toucher, inconfort persistant. La maison, censée protéger, devient un piège humide. Un coup d’œil à certains bâtiments anciens suffit : des auréoles blanchâtres de salpêtre trahissent la lente migration des minéraux, signe que l’eau a déjà emprunté le chemin du mur.
Agir rapidement s’avère souvent décisif. Installer une ventilation mécanique contrôlée (VMC) aide à renouveler l’air et freiner la condensation. Mais pour couper l’humidité à la racine, c’est à la base des murs que tout se joue.
La bande d’arase : un rempart discret mais décisif face aux infiltrations
Savez-vous ce qui se niche au cœur du mur, à la naissance du bâti, entre le sol et la première rangée de blocs ? Une mince feuille de quelques millimètres, la bande d’arase. Composée de fibres de polyester ou de verre, imprégnées de bitume et de polymères, elle ne paie pas de mine. Et pourtant, placée entre deux couches de mortier de ciment, elle fait barrage aux remontées d’humidité juste au-dessus des fondations.
Sa pose n’est pas un détail technique réservé aux puristes : dans les maisons neuves, certaines réglementations (DTU 20.1 pour la maçonnerie, 23.1 ou 31-2 selon les cas) la préconisent noir sur blanc. Son rôle ? Protéger la maçonnerie traditionnelle aussi bien que l’ossature bois, fragile au contact de l’humidité.
Associée, si besoin, à une membrane d’étanchéité ou à un accessoire complémentaire, la bande d’arase ne laisse aucune chance à l’humidité de passer. Une fois en place, elle agit durablement contre les infiltrations liées à la condensation, et garantit la stabilité de l’ensemble pour des années.
Voici concrètement ce qu’apporte ce dispositif :
- Arrêter les infiltrations d’eau remontant par capillarité
- Empêcher la détérioration liée au salpêtre ou aux moisissures
- Assurer la conformité avec les règles techniques de la construction neuve
Sa discrétion est totale, mais ses effets sont puissants. Omettre la bande d’arase, c’est risquer, pour le futur propriétaire, des dégâts souvent irréversibles. Sa présence confère à la maison une force tranquille, invisible, mais décisive.
Choisir la bande d’arase : quels critères prendre en compte ?
Impossible de s’en remettre au hasard. La sélection de la bande d’arase dépend du projet et du support à protéger. Maçonnerie traditionnelle ? Ossature bois ? Il faut adapter la nature de la bande et vérifier qu’elle sera réellement efficace une fois posée.
Dans le cas d’une maçonnerie en blocs, il vaut mieux choisir une version souple, issue de fibres de polyester ou de verre, renforcée par du bitume et des polymères. Ceci offre une excellente résistance à la putréfaction et tient le choc même si l’humidité s’installe. Pour l’ossature bois, l’objectif est de protéger en priorité la base du bois, particulièrement perméable.
La mise en œuvre se réalise toujours entre deux couches de mortier de ciment, parfois avec un additif hydrofuge. Ce mélange, couplé à la bande d’arase, isole radicalement contre l’humidité montante.
Les règles sont claires : DTU 20.1 pour la maçonnerie, DTU 31-2 pour le bois. Elles exigent en général une épaisseur d’environ 2 mm et une largeur couvrant l’ensemble du mur. Pour des situations complexes, des accessoires complémentaires, comme une membrane ou un crochet drainant, permettent de renforcer la barrière.
Voici les principaux éléments à évaluer avant de choisir :
- Nature du support à protéger (béton, brique, bois)
- Épaisseur et largeur réelle de la bande
- Respect des règles techniques applicables (DTU)
- Compatibilité avec un mortier hydrofuge
Étapes et conseils pratiques pour réussir la pose d’une bande d’arase
L’installation intervient dès que les fondations sont prêtes, juste avant d’élever les murs. On place la bande, souple et résistante, toujours à l’horizontale, entre deux couches de mortier de ciment. Il faut viser au minimum 2 mm d’épaisseur, avec une largeur supérieure à celle du mur pour garantir une protection totale.
Avant de commencer, on vérifie que la surface est plane, propre et sèche. La bande doit rester parfaitement à plat, sans plis ni bulles d’air. Les recouvrements entre deux lés doivent mesurer au moins 10 cm pour éviter tout passage d’eau. Elle déborde légèrement de l’arase, ce qui protège jusqu’au niveau du sol fini.
Un conseil de pro : une pose sans interruption, sans espace entre deux bandes, est impérative pour l’efficacité de la barrière. Les angles et ruptures de niveau exigent encore plus de rigueur au montage. Concernant l’ossature bois, la bande isole parfaitement pour empêcher toute humidité de fragiliser le bas de la structure.
À ne pas négliger non plus : le drainage. Installer un drain, bien protégé par un géotextile et relié à un caniveau ou un point d’évacuation, aide à éloigner l’eau du bâti. Si la maison existe déjà sans bande d’arase, l’injection de résine hydrophobe dans les murs crée une barrière ultérieure. Enfin, la ventilation mécanique contrôlée (VMC) reste une mesure salutaire pour assainir l’air intérieur.
Un bandeau discret, invisible derrière le plâtre ou la peinture, mais qui décide du sort de la maison pour des décennies. La bande d’arase, sans bruit ni fard, dessine la frontière entre la confiance dans son logement… et l’éternelle crainte de l’humidité.